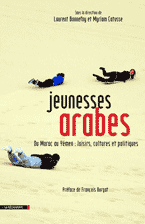
1/ Laurent Bonnefoy et Myriam Catusse (dir.), Jeunesses arabes. Du Maroc au Yémen : loisirs, cultures et politiques Préface de François Burgat, Paris, La Découverte, 2013, 373 pages.[1]
Parce que les jeunes ont occupé le devant de la scène lors des soulèvements arabes de 2011 et 2012, les médias se sont vite emparés de l’image plaisante d’une nouvelle classe d’âge mondialisée, pacifiste et branchée, se mobilisant contre des régimes autoritaires dans une joyeuse spontanéité où s’inventait un répertoire d’action inédit. Parallèlement, ils ont opposé cette nouvelle représentation à une autre, tout aussi stéréotypée, celle des islamistes. Depuis, ces mouvements ont connu des évolutions incertaines ou même tragiques, et cette perception renouvelée de la jeunesse, alors même qu’elle bousculait déjà de manière bienvenue les clichés sur le monde arabe, a dû être nuancée, voire complexifiée. La diversité notamment se devait d’être réintroduite au sujet d’un groupe qui se décline au pluriel, illustrant à nouveau la célèbre formule de Bourdieu : « La jeunesse n’est qu’un mot »[2]. Loin de former une catégorie homogène, les jeunes Arabes appartiennent en effet, comme tous les autres jeunes, à différentes classes sociales, identités religieuses et orientations politiques, entre autres. D’ailleurs, parmi ceux qui ont participé aux soulèvements, où les organisations politiques étaient loin d’être absentes, beaucoup avaient déjà connu des formes d’engagement, ce qui jette un nouvel éclairage sur la question de la soudaineté et de la spontanéité de leurs mobilisations.
Laurent Bonnefoy et Myriam Catusse se sont donc attelés à « déconstruire les stéréotypes » (leur introduction, p. 11) et brossent ici un tableau aussi varié que vivant des jeunesses arabes contemporaines. Pour cela, ils ont réuni plus d’une trentaine d’auteurs[3] dont les contributions se caractérisent par une grande richesse ethnographique. Loin de porter un regard en surplomb, les chercheur-e-s mentionnent souvent leur position personnelle, voire la façon dont les acteurs ont pu les interpeller ou les prendre à parti. Le lecteur se trouve alors plongé au cœur de la vie de ces jeunes et la qualité des terrains, dont témoigne notamment l’abondance des récits d’interactions et des extraits d’entretiens ou de conversations, permet une vision tout en finesse, au plus près des réalités vécues. L’angle d’approche lui-même est relativement inédit. Au lieu de se concentrer sur la question de l’engagement politique, les auteur-e-s ont voulu approcher cette jeunesse par le biais des loisirs et du temps libre. À rebours de la définition classique mannheimienne de génération, qui s’ancre dans l’exposition à un événement politique commun, ils étudient la façon dont les loisirs « contribuent à faire génération » et mettent au jour les nombreuses et diverses sous-cultures construites par ces jeunes pour se composer un entre-soi alternatif, alors qu’entre chômage et recul de l’âge du mariage le temps de la jeunesse se prolonge. Les quatre parties qui composent cet ouvrage collectif abordent ainsi les figures et pratiques emblématiques d’une époque pour les acteurs concernés, leur rapport au passé et leur projection dans le futur, leur construction de soi et leurs modalités de prise de parole.
Les études consacrées aux jeunes islamistes (première partie intitulée « Vivre son époque ») montrent combien l’angle des loisirs peut se révéler fructueux quand il s’agit de complexifier une approche souvent élaborée uniquement à partir du politique. Le passage par l’islam politique peut ainsi constituer seulement l’une des étapes d’un parcours et déboucher sur une autre recherche plus personnelle et spirituelle, comme pour ces jeunes Syriens qui, attirés par l’islam politique et la contestation dans une mosquée, y découvrent petit à petit des rituels soufis qui finissent par les séduire (Thomas Pierret). Au Yémen, des étudiants salafistes se révèlent être peu au fait du contenu de leur propre doctrine, laquelle a pour eux plus à voir avec une pratique de rébellion adolescente, une volonté de dissociation et de rejet symbolique de leur société, qu’avec une fonction politique ou religieuse (L. Bonnefoy). Les nuances sont également de mise au sujet de la place des femmes et des constructions de genre. En Tunisie, une jeune militante qui rejette le répertoire pacifique habituellement associé aux femmes obtient néanmoins l’estime générale par son engagement (Amin Allal), tandis qu’en Arabie Saoudite, des buya (de l’anglais boy), adoptent un style « masculin » qui transgresse les normes de la féminité « respectable » (Amélie Le Renard), mais représente aussi l’importation d’une référence à une série américaine, revisitée et réinterprétée, et une pratique de consommation.
En effet, même s’ils se positionnent différemment, tous ces jeunes circulent dans un champ aux références variées qui s’étend du local au global. L’intégration dans une société de consommation aux marques mondialisées participe de ce mouvement et les identifications croisées vont bien au-delà du monde arabe. Les fans de football vibrent à chaque match du Real de Madrid et du Barça de Barcelone dans lesquels, par ailleurs, certains supporters palestiniens projettent une lutte des opprimés contre un centre dominant (Abaher El Sakka). Lorsque le camp palestinien est reconstruit en ghetto urbain par le rap, d’autres identifications à d’autres combats, comme ceux des Aborigènes ou des noirs américains, deviennent possibles (Nicolas Puig, quatrième partie intitulée « Prendre la parole »). Au Yémen, un artiste a pu trouver, via l’importation du street art, un nouveau registre de critique sociale et une nouvelle audience pour son œuvre restée jusque-là confidentielle (idem, Anahi Alviso-Marino).
Mais ces circulations entraînent également des positionnements à des niveaux multiples, qui sont loin d’être en continuité les uns avec les autres et dont les normes respectives ne s’imposent pas de manière égale. L’étude qui porte sur l’art engagé en Palestine montre ainsi que, du fait de la reconnaissance internationale et de financements en provenance d’une fondation, les artistes se sont repositionnés dans le champ et se conforment désormais aux attentes d’un marché international de l’art contemporain (Marion Slitine). Certains groupes de rock et de rap peuvent aussi obtenir sur la scène internationale une médiatisation sans commune mesure avec leur impact national (Layla Baamara, Dominique Caubet et Catherine Miller). De manière plus générale, les bailleurs de fonds occidentaux, fort occupés à construire la fameuse « société civile », ont une nette influence sur les associations et les loisirs, en encourageant l’alignement des pratiques sur leur propre vision. Ils sélectionnent et soutiennent celles qui sont conformes à leurs attentes et à leurs valeurs, indépendamment du succès ou de l’adéquation au niveau national et local. Même s’il est important de souligner la diversité qu’entraînent ces circulations de références et le large éventail dans lequel puisent les acteurs qui peuvent tout aussi bien faire appel à des traditions réinventées qu’aux dernières formes d’un consumérisme globalisé, il convient de noter que, là aussi, rapports de force et hiérarchies sont à l’œuvre.
Si le secteur associatif, réputé éloigné du politique, bénéficie à ce titre d’une indéniable aura, c’est pourtant par lui que s’opère la majorité des porosités entre pratiques de loisirs et engagement. Certes, l’épanouissement personnel est mis en avant et les registres antécédents de l’engagement politique sont délaissés. À cet égard d’ailleurs, la comparaison peut être faite entre jeunes Palestiniens et jeunes Algériens, pour lesquels la réussite personnelle semble prendre une importance grandissante (Kamel Chachoua). Toutefois, dans certains cas, la pratique de loisirs peut s’articuler à une logique partisane, comme pour le théâtre chiite au Liban (Catherine Le Thomas). Et comme le montre Romain Lecomte au sujet du cyberactivisme en Tunisie, ce sont les pratiques de répression elles-mêmes, et en l’occurrence la censure, qui ont contribué à brouiller les registres en rapprochant de simples internautes en quête de divertissement et de véritables cyberdissidents.
Circulations et recompositions se retrouvent dans la temporalité de ces jeunes, avec un rapport au passé qui supporte toutes les réinventions et toutes les réappropriations et qui semble bien plus une richesse qu’un carcan, même s’il prend parfois des allures d’âge d’or fantasmé. Le poids de ce passé, qui peut même encourager la créativité, n’empêche pas, de toute façon, le plein ancrage dans un présent qui dépasse largement les frontières du monde arabe et se révèle à ce titre « global », voire, pour certains, autosuffisant. C’est la projection dans le futur qui se révèle peut-être la plus délicate. Certaines pratiques ou sous-cultures, et notamment les plus transgressives, ignorent l’avenir. Elles peuvent cependant, comme le montrent des études longitudinales, l’orienter de manière déterminante. C’est le cas de ces lycéennes en rupture de ban, rattrapées par un lent glissement du festif à la prostitution (Mériam Cheikh), mais aussi de ceux qui, à l’inverse, pratiquent avec assiduité les loisirs de leur classe, y contractent les habitudes et y forgent les liens qui renforceront leur inclusion (Claire Beaugrand). La projection dans un futur collectif qu’impliquent les pratiques les plus liées au politique ou à des projets de société n’est pas toujours aisée. La nostalgie de la jeunesse de gauche beyrouthine (Nicolas Dot-Pouillard) exprime ainsi le difficile renouvellement des horizons politiques et une attente de paradigmes nouveaux et alternatifs, attente dont les premiers moments des révoltes arabes ont montré toute l’importance, mais qui peine cependant à se concrétiser en projet précis.
En analysant ces tensions, en donnant à voir la diversité des orientations et des sous-cultures, l’ouvrage dirigé par L. Bonnefoy et M. Catusse nous offre un panorama qui, dans sa variété même, parvient à restituer l’ambiance unique dans laquelle cette nouvelle génération vit et agit.
2/ Sadik Jalal Al-Azm, Ces interdits qui nous hantent : Islam, censure, orientalisme, Marseille, Parenthèses/ MMSH/ IFPO, 2008, 186 p.[4]
Sadik Jalal Al-Azm revient sur les contradictions entre enseignement religieux et science contemporaine et s’oppose à ce qu’il définit comme un concordisme stérile ; il refuse ainsi l’évolution « islamicisante », comme il la nomme, de certains de la gauche arabe qui réinscrivent dans l’islam une authenticité arabe. Mais à ses adversaires politiques, religieux ou intellectuels, il propose un « pacte d’honneur » : « livre pour livre, poème pour poème (…) et que tous les mois soient saints » (p. 58) ; autrement dit priorité au débat et que disparaissent les attaques personnelles et les menaces physiques. Ces interdits qui nous hantent, le premier recueil de textes de Sadik Jalal Al-Azm en français (Parenthèses/ MMSH/ IFPO, 2008) témoigne de cette ambition, dans une belle traduction de l’arabe ou de l’anglais par Jalal El Gharbi et Jean-Pierre Dahdah, révisée par Franck Mermier et Candice Raymond. L’ouvrage regroupe un long entretien réalisé par Saqr Abou Fakhr en 1998, et trois articles, l’un sur les attentats du 11 septembre (publié pour la première fois en 2004), un autre sur Les Versets sataniques et la « fatwa » (qui n’en était pas une stricto sensu, comme le montre Sadik Jalal Al-Azm) de Khomeyni (1e éd. 2000), et enfin un dernier article sur L’orientalisme d’Edward Saïd (1e éd. 1981).
Tout au long du recueil, le questionnement sur les rapports de domination post-coloniaux s’impose comme thème central. Ainsi, dans son essai sur Les Versets sataniques, Sadik Jalal Al-Azm mêle de manière particulièrement intéressante critique littéraire et analyse politique. Il y voit véritablement une œuvre de la mondialisation et se révèle fasciné par l’appropriation de la « lingua franca de la mondialisation » effectuée par Salman Rushdie : « un immigré indien (…) a tordu cette langue pour qu’elle serve son propos, l’a ployée pour qu’elle se conforme à son expérience, l’a distordue pour obtenir les résultats attendus, l’a rendue hybride pour qu’elle satisfasse ses besoins particuliers, l’a rendue exotique pour qu’elle puisse exprimer un monde étranger et puis il a fait rayonner cette nouvelle mixture littéraire sur le monde entier » (p. 109). Pour lui, il s’agit d’une démarche clairement post-coloniale. En s’emparant et en modifiant la langue du colonisateur, les anciens colonisés deviennent ceux qui interpellent le plus significativement le monde contemporain. Cette double posture de description et de transformation, Sadik Jalal Al-Azm la retrouve dans le traitement stylistique de Salman Rushdie. Celui-ci évoque la « chosification » de la mondialisation, le fétichisme des objets qui y règne, mais à travers la description du flux de conscience de ses personnages, il remet aussi en cause la dépersonnalisation qui s’ensuit. Enfin, la scène même du débat déclenché autour du livre de Salman Rushdie devient mondiale, le « centre » occidental, tout comme les « périphéries » se sentent concernés.
Ce dépassement, ce retournement post-colonial, intéresse tout particulièrement Sadik Jalal al Azm, lui qui reproche aux orientalistes, mais aussi aux « orientalistes à l’envers » de se confiner dans les querelles obsolètes des Anciens et des Modernes. De quoi s’agit-il ? L’auteur dénonce un orientalisme ontologique où l’Orient est construit en un système réifié et immuable de croyances et de valeurs. La tautologie typique de cet orientalisme se réduit à : « L’islam est l’islam » ou « l’Orient est l’Orient », comme l’a montré Edward Saïd (p. 174). L’orientalisme à l’envers applique la même démarche et continue à réifier et déhistoriciser le Proche-Orient et les Arabes, en les valorisant cette fois. Cette remarque est devenue usuelle dans l’analyse des doctrines islamistes. Mais Sadik Jalal Al-Azm la dirige aussi contre les « islamicisants » de la gauche arabe, ces militants qui valorisent désormais une identité arabe et musulmane ahistorique pour pallier aux divers échecs politiques et idéologiques. Les débats s’enferment alors dans les oppositions habituelles : authenticité et contemporanéité, patrimoine et renouvellement, laïcité et religion. Comme dans l’orientalisme classique, une importance essentielle est donnée aux analyses linguistiques, à la « posture textuelle », identifiée par Edward Saïd (cité p. 170) : « la langue parle l’arabe oriental et non l’inverse ». Les facteurs idéologiques sont survalorisés et les questionnements économiques ou sociologiques oubliés. Cependant Sadik Jalal Al-Azm va plus loin. En effet, pour lui, Edward Saïd reste finalement prisonnier de la démarche orientaliste en faisant une présentation « linéaire et quasi-essentialiste des origines et du développement de l’orientalisme » (p. 154), qu’il fait remonter à l’antiquité. S’il prône une remise en cause des « systèmes de fiction idéologique », Edward Saïd appelle à une réforme plutôt qu’une abolition totale de la relation de dépendance entre les États-Unis et le Proche-Orient, ce qui pour Sadik Jalal Al-Azm peut finalement se révéler plus dangereux.
Toutefois on peut se demander si l’auteur qui analyse si bien cet enfermement chez Edward Saïd, n’adopte pas lui aussi parfois cette posture. Certes, il ne verse aucunement dans l’essentialisation. Mais lorsqu’il affirme qu’après la nahda « un diagramme montrerait une nette tendance vers la rationalité, l’objectivité, la rigueur méthodologique, la clarté et une régression du ton oratoire dans les écrits, dans la culture et dans la pensée ainsi qu’une disparition de l’ornement lexical, des fioritures de la prose rythmée » (p. 56) ou à propos des attentats du 11 septembre « Depuis quand les Arabes sont-ils capables d’une telle organisation stratégique ? (…) Ils [les mudjahidin en Afghanistan] ont tourné l’effet dévastateur de leur apprentissage contre les maîtres eux-mêmes [les Américains] » (p. 82), on semble retrouver ici certains accents des oppositions binaires classiques (rationalité/irrationalité, modernité/tradition, etc.) que Sadik Jalal Al-Azm appelait à dépasser. La reprise de l’usage du pluriel pour le dominant et du singulier pour le dominé, une des étapes du processus de réification, surprend dans quelques passages (par exemple, p. 159 « l’invisible est beaucoup plus immédiat et réel pour le simple citoyen du Caire ou de Damas qu’il ne l’est pour les habitants actuels de New York et de Paris). La difficulté à sortir de cette dialectique même pour les auteurs qui en sont les plus conscients montre combien la scène politique et intellectuelle est véritablement structurée autour de ces catégories et combien il est délicat d’appeler à la rationalité et à la scientificité en évitant de remobiliser les grandes divisions traditionnelles de l’orientalisme.
[0] Pénélope Larzillière est sociologue, chercheure habilitée à diriger des recherches à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Ses travaux portent sur l’engagement politique et le militantisme, y compris les formes extrêmes, et sur les circulations idéologiques. Elle travaille également sur l’art contestataire. Elle a mené de longues enquêtes de terrain au Proche-Orient. Parmi ses publications, on compte notamment les ouvrages Activism in Jordan (Zed Books, 2016), La Jordanie contestataire. Militants islamistes, nationalistes et communistes (Actes Sud, 2013) et Être jeune en Palestine (Balland, 2004). Elle a également co-dirigé les numéros de revue “Révolutions, contestations, indignations” (Socio, 2013), et “Faut-il désoccidentaliser l’humanitaire” (Humanitaire, 2010). Elle est membre du comité de pilotage de l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) et membre du comité de rédaction de la revue Socio.
[1] Ce compte-rendu de lecture a été publié dans Critique internationale : Larzillière, Pénélope, Compte-rendu de lecture « Laurent Bonnefoy et Myriam Catusse (dir.), Jeunesses arabes, La Découverte, 2013 », Critique internationale, 2014/3, p. 153-156.
[2] Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, Paris, Éditions de Minuit, 1984, p. 143.
[3]. Outre les auteurs dont les contributions sont mentionnées ici, ont également collaboré à l’ouvrage : Zahra Ali, Mahfoud Amara, Laure Assaf, Enrico De Angelis, Youssef El-Chazli, Anne-Marie Filaire, Mariangela Gasparotto, Yves Gonzalez-Quijano, Xavier Guignard, Laure Guirguis, Mohand Akli Hadibi, Christine Jungen, Perrine Lachenal, Loïc Le Pape, Pascal Ménoret, Marine Poirier, Arthur Quesnay, Cyril Roussel, Victoria Veguilla Del Moral.
[4] Ce compte-rendu de lecture a été publié dans les Annales. Histoire, Sciences sociales : Larzillière, Pénélope, Compte-rendu de lecture « Sadik Jalal Al-Azm, Ces interdits qui nous hantent : Islam, censure, orientalisme, Marseille, Parenthèses/ MMSH/ IFPO, 2008, 186 p. », Annales. Histoire, Sciences sociales n°4, juillet/août 2010, pp. 1042-1043.
